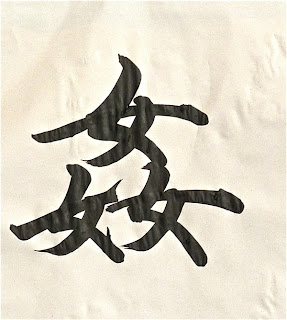Même si j'ai quitté le sérail, je m'intéresse toujours à l'université et à sa mission première d'enseignement et de formation.
Deux sujets ont retenu mon attention ces derniers jours :
- la pédagogie. Une pression de plus en plus insistante est faite aujourd'hui sur mes collègues encore en place pour l'adoption de pédagogies inter-actives, censées favoriser l'autonomie et l'acquisition de compétences plutôt que de connaissances. Cela pose la question de la liberté académique ;
- la question de la "double casquette". De moins en moins de professeurs d'université se consacrent à temps plein à leur mission première, qui est l'enseignement et la recherche. Ils ont un pied ailleurs, par choix ou parce que cela va aujourd'hui de soi. Cela pose la question de la liberté scientifique.
Comme ces deux sujets m'inspirent particulièrement, je les aborderai en deux articles distincts. Voici le premier.
Premier sujet: à propos de la liberté académique
A son dernier cours, mon professeur de droit commercial, admis à l'éméritat, avait résumé ce qu'il espérait avoir fait au cours de sa carrière de professeur (il s'agissait de Charley del Marmol) : transmettre un savoir, un savoir-faire et un savoir-vivre. J'aime assez cette vision, humaniste, du rôle du professeur d'université. Et tout autant, l'idée de transmission. Elle crée une continuité où l'ancien est reconnu par le plus jeune et le plus jeune par l'ancien. Le plus jeune deviendra, un jour, un ancien, mais, dans ce modèle, il apprend aussi qu'il doit attendre un peu. Un professeur, pour moi, se définit comme quelqu'un qui transmet.
J'ai découvert, pour la première fois, ceux que l'on appelle les "pédagogues", quand ma faculté m'a demandé de siéger dans le jury de l'agrégation pour l'enseignement secondaire en sciences sociales. C'est alors que j'ai rencontré pour la première fois des "pédagogues "(je veux dire des universitaires qui ont fait de la pédagogie un objet de recherche, de propositions et ... d'endoctrinement) ; bien avant cela, j'avais déjà croisé évidemment de grands pédagogues chez les bons pères et même à l'université, d'une toute autre envergure que ceux-là. Ils étaient de grands pédagogues parce qu'ils avaient cela dans le sang, et non parce qu'ils avaient appris des techniques et des formules. Ils sentaient ce qu'il fallait faire. Parce qu'ils étaient nés pédagogues, ils sont devenus naturellement enseignants. Ceci va faire hurler bien entendu les nouveaux "pédagogues", eux qui généralement ne savent pas enseigner et conçoivent des formations destinées à permettre à des non-pédagogues par nature de devenir enseignant.
J'ai découvert, au contact de ces étranges collègues, que mes étudiants devaient être appelés des "apprenants" et que moi, je ne devais plus me définir comme enseignant, mais comme "encadrant".
Il faut dire que leur leitmotive était, et est toujours, celui-ci : l'apprenant n'est pas à l'école (ou à l'université) pour apprendre, mais pour apprendre à apprendre, afin d'être efficace. Pour eux, ce sont les compétences qui comptent, c'est-à-dire le savoir-faire, fort peu le savoir ... quant au savoir vivre ?
J'ai retrouvé ces mêmes collègues, un peu plus tard, quand la faculté m'a propulsé comme "expérimentant" d'un projet d'enseignement "on line" et "interactif", avec l'espoir d'un syllabus truffé de liens hypertext, des QCM, une correction automatique de ceux-ci, des graphiques révélant le degré d'assimilation de l'apprenant, des jeux de rôle et autres simulations, et j'en passe. Cette expérience fut un échec cuisant, pour deux raisons : elle ne répondait en rien à l'attente des étudiants, qui préférait le professeur à leur ordinateur, et, plus je m'y aventurais, plus j'y voyais d'inconvénient, le plus important étant qu'il demandait de ma part un investissement totalement disproportionné au vu de l'enjeu. Etre dans l'air du temps semble être parfois le mot d'ordre des autorités de mon université.
Mon excellent ami N. m'a rapporté que des "pédagogues" sont récemment venus expliquer aux "encadrants" de la Faculté de droit que l'enseignement ex cathedra doit être banni, au moins en "master" et, si possible, avant. L'apprenant doit apprendre à se débrouiller seul, avec un encadrement. Bigre, et le savoir, sans lequel le savoir-faire ne sert à rien, quand les apprenants le découvriront-ils ? On suppose, j'imagine, qu'ils l'apprendront par eux-mêmes en consultant des documents et des dossiers avec l'aide de leur encadrant.
Cela fait maintenant deux ou trois décennies que ces "pédagogues" nous tiennent le même discours à propos de l'enseignement primaire et secondaire. Voilà qu'ils en remettent une couche au niveau universitaire : le diplôme doit attester de compétences, non d'un savoir. Je suis d'accord, mais quelles compétences ?
Je n'aurais peut-être pas évoqué le sujet, si je n'avais lu ce matin les résultats d'une enquête menée auprès de professeurs d'université et dont la conclusion est sans appel : le niveau des étudiants qui abordent l'université ne cesse de baisser depuis dix ans.
Certes, il ne s'agit que de professeurs d'universités flamandes et aucun professeur de la Katholieke Universiteit Leuven (K.U.L.) n'a daigné répondre. Il y a donc un biais. Néanmoins, si des professeurs d'université en Flandre aboutissent à cette conclusion, cela doit être aussi le cas, peut-être plus encore, dans la partie francophone du pays. Selon l'article, la réforme de Bologne serait aussi en cause ; je ne vois pas en quoi. Les universités, jusqu'à présent, ont pris acte de la situation et, sans baisser leurs exigences, ont proposé des remédiations. Mais aujourd'hui, le vers est dans le fruit. Alors que leurs théories s'avèrent être un échec patent dans l'enseignement fondamental et secondaire, ne voilà-t-il pas que les mêmes "pédagogues" tentent de les appliquer à l'université !
Aussi loin que je remonte dans mon expérience d'enseignant à l'université, j'ai toujours, lors de mon premier cours, distingué la matière enseignée (le droit fiscal, en l'occurrence) et ce que cette matière allait permettre de faire, tout au long de l'année, sur le plan de la formation intellectuelle (appelons-cela les compétences que je voulais promouvoir). Je l'illustrais d'ailleurs dès le premier cours avec quelques anecdotes. Ma méthode d'enseignement a toujours été fondée sur la valeur de l'exemple, les meilleurs si possible, mais aussi parfois, je l'avoue, les très mauvais pour en tirer une leçon. L'"apprenant", j'en suis convaincu, apprend beaucoup plus en se confrontant à l'exemple des maîtres qu'en se confrontant à lui-même, même encadré.
Le cours ex cathedra a une grande vertu que n'auront jamais les travaux de recherche, fatalement sur des sujets ponctuels, demandés aux étudiants : il fournit une synthèse, une distance et parfois, si le professeur est bon, une vision. Pour un jeune esprit, cela est, me semble-t-il, toujours bénéfique, et parfois même fondateur. Cela serait une grave erreur de priver nos jeunes étudiants de cette expérience. Cela veut dire aussi que les critères de sélection des professeurs doivent prendre cette dimension en cause : l'université a besoin de visionnaires. Peu de professeurs d'université aujourd'hui peuvent prétendre à ce rôle, cela est regrettable ; il en est ainsi, dans ma faculté, pour des raisons qui apparaîtront dans mon deuxième article et qui tiennent aux critères de recrutement.
Quelles étaient donc les compétences que je souhaitais promouvoir, quand j'étais professeur ?
J'ai fini par les écrire dans mes engagements pédagogiques, vu que dorénavant le professeur doit prendre un engagement vis-à-vis de ses étudiants, afin que ceux-ci puissent invoquer l'un ou l'autre manquement de leur "encadrant", en cas d'échec, pour un recours administratif. Je devais être tellement clair qu'il n'y a jamais eu aucun recours contre mes évaluations à l'examen (pourtant oral, donc présumé être plus subjectif). A ces examens oraux, je consacrais aussi le temps qu'il fallait (trois à quatre semaines par an au moins) ; n'étais-je pas payé pour cela ?
J'expliquais à mes étudiants que mon cours leur apprendrait certes le droit fiscal (le savoir), mais qu'il les amènerait surtout, à propos du droit fiscal, à exercer notamment les compétences suivantes (le savoir-faire) :
- passer sans cesse du général au particulier et du particulier au général ;
- toujours aborder une norme, surtout les plus techniques d'entre elles, en tenant compte de son contexte, de son histoire, des négociations gouvernementales qui en ont fait un compromis improbable, mais acceptable, de ses interprétations successives, de ses zones d'ombre, de son rapport à d'autres normes ;
- faire preuve d'esprit critique à propos de certains énoncés ou déclarations ;
- découvrir les nuances, parfois très subtiles, distinguant certaines théories ou argumentations ;
- aborder un même problème avec différents angles d'attaque ... et ne pas baisser les bras, quand tel angle échoue, afin de pouvoir considérer les choses autrement ;
- expérimenter le fait que le droit n'est pas cloisonné en différentes matières, mais que celles-ci sont constamment liées entre elles et qu'il faut donc parfois aller chercher ailleurs la solution ;
- se poser des questions avant d'espérer ou d'attendre des réponses et, faire preuve d'imagination, le cas échéant.
Il s'agit de quelques-unes des compétences les plus essentielles, me semble-t-il, qu'il convient de transmettre à un jeune étudiant à l'université.
En est-il encore ainsi aujourd'hui ? J'en doute, quand je considère l'évolution des programmes et celle annoncée des méthodes.
Aujourd'hui, les compétences attendues semblent plutôt être les suivantes (il suffit de lire la présentation officielle des études, sur le site de la faculté de droit de l'ULg) : pouvoir rédiger des conclusions, l'exposé des motifs d'une loi, un rapport pour un conseil d'administration ; apprendre à s'insérer dans une équipe ; avoir découvert comment fonctionne un cabinet d'avocat, une administration ou une étude de notaire et en faire rapport ; s'être initié à la plaidoirie ; avoir répondu aux demandes d'un maître de stage qui accueille l'étudiant pour un temps limité ; prouver qu'on a voyagé (le plus possible, si possible, car les études suivies à l'étranger - ou plus généralement ailleurs que dans sa propre faculté - sont toujours considérées meilleures que celles suivies dans celle-ci) ... bientôt on apprendra aussi, à l'université, comment choisir sa toge d'avocat et quelle procédure suivre pour s'inscrire au Rotary. Il ne s'agit plus du tout de savoir-faire, mais d'une espèce de conditionnement à certaines professions, sur un mode utilitaire.
Une des raisons de ma désaffection pour mon métier a été de m'entendre répéter, année après année, que mon principal enseignement (120 heures), auquel je me consacrais, et vouais l'essentiel de mon temps, n'était pas si essentiel pour nos étudiants locaux, puisqu'il valait mieux qu'ils aillent se former ailleurs (mieux ?) à l'étranger ... Pour me rassurer, on me disait que cet enseignement pourrait peut-être intéresser des étudiants étrangers, débarquant de Pontoise. Alors que ma faculté jouait ce jeu-là, je reçois aujourd'hui encore des témoignages d'étudiants qui ont suivi mon enseignement et m'en remercient. Comme quoi, on peut être nié par sa faculté et reconnu par ses étudiants.
Je ne sais pas si cela tient aux étudiants espagnols et italiens, mais il était évident que je ne pouvais leur appliquer les mêmes critères d'évaluation qu'à mes étudiants du terroir. Si cela avait été le cas, ils auraient tous échoués. Cela était bien entendu inadmissible et de nature à compromettre nos accords avec leur université d'origine ! J'avais oublié, il est vrai, que, selon les "pédagogues", mes évaluations devaient respecter la courbe de Gauss. On m'a fait comprendre, au cabinet décanal, que je devais être indulgent, car ils font quand même un gros effort sur le plan de la langue. Fort bien, mais il doit en être de même alors pour nos étudiants partis à l'étranger. On doit aussi leur donner là-bas une note d'indulgence ; celle-ci est ensuite traduite sur la base de critères incompréhensibles, pour leur délibération en Belgique, conversion qui surestime le plus souvent l'étudiant (il y a eu des exceptions), et, en délibération, certains se permettent encore de soutenir qu'il faut leur accorder un petit "plus" parce qu'ils ont quand même dû fournir un effort sur le plan de la langue supérieur à ceux de leurs condisciples plus casaniers !
Pour ce genre de raisonnement, aussi, j'ai pris mon environnement professionnel en grippe.
Prenons maintenant deux exemples :
- supposons un chargé d'enseignement qui pense que la meilleure manière d'enseigner, à ses yeux, est le cours ex cathedra, car il a des vertus indéniables et parce c'est comme cela qu'il livre le meilleur de lui-même : aura-t-il encore la liberté académique de le faire ?
- lors de l'engagement d'un nouvel enseignant pour un poste vacant, sa soumission à l'idéologie des "pédagogues" sera-t-elle un critère de sélection le favorisant ou, dans le cas contraire, un motif d'exclusion ?
Je dois bien avouer que je suis fort inquiet, après tout cela, quant à la liberté académique et quant au pouvoir disproportionné d'une certaine coterie dans mon université.